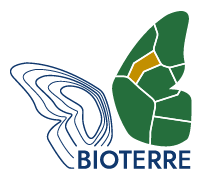Raison d’être et projet
Repenser la place de la nature en ville et dans les aménagements ; accompagner une transition des régimes alimentaires en lien avec l’atténuation du réchauffement climatique et la santé des populations ; œuvrer à l’émergence d’une protection du vivant non-humain qui soit réellement compatible avec les usages et les pratiques des populations locales ; trouver le juste équilibre entre prélèvement de ressources et qualité des milieux et des écosystèmes ; autant de sujets qui montrent combien les questions de biodiversité se trouvent au cœur d’enjeux de première importance. Des enjeux qui supposent de solides connaissances scientifiques et des savoirs techniques et méthodologiques éprouvés. Des enjeux qui requièrent aussi des approches adaptées à la pluralité des acteurs et des logiques en présence, et une réelle capacité à écouter, à agir et à négocier en univers complexe et multidimensionnel.
Tel est le projet de formation développé par le Master BIOTERRE : permettre aux étudiantes et étudiants d’appréhender les questions de biodiversité de manière globale et non partisane, dans tous les types de configurations et de contextes ; non pas de manière sectorielle mais ouverte à la complexité du monde et attentive aux différentes composantes et échelles qu’il s’agit de prendre en compte conjointement ; avec toute la nuance et la subtilité qu’impose la diversité des intérêts, des motivations et des stratégies à l’œuvre. Ceci afin de ne pas renforcer les situations bloquées et les oppositions stériles, qui n’aident pas à faire face aux crises multidimensionnelles qui ébranlent nos sociétés.
Au cours de la formation, les étudiants acquièrent ainsi des connaissances variées et une expertise pointue, tout en développant une réelle aptitude à aborder de manière transversale et systémique des problématiques souvent complexes et multiacteurs. Polyvalents, elles et ils développent leur capacité de répondre à un large éventail de défis dans le domaine de la gestion territorialisée de la biodiversité.
Les maîtres-mots de la formation
Diversité : des profils de recrutement, des intervenants (scientifiques, experts, professionnels…), des mises en application et des exercices de terrain, des perspectives d’emploi.
Pluridisciplinarité : plus de cinquante intervenants couvrant des champs disciplinaires et des domaines professionnels extrêmement variés.
Convivialité : l’équipe pédagogique accorde beaucoup d’importance à l’instauration d’un climat de respect, de convivialité et de coconstruction avec la promotion. Tout au long de la formation, des sorties de terrain et des voyages d’étude et de cohésion contribuent à le renforcer.
Créativité : outre les différents projets et ateliers, les étudiant·es sont invités à proposer des intervenants et des activités ; de surcroît, le Master encourage et soutient les projets innovants et disruptifs que des étudiants voudraient développer, pendant l’année de Master ou même après.
Évolutivité : sous l’effet des interactions fortes qu’il développe avec la communauté scientifique et les différents gestionnaires du vivant, le Master se renouvelle chaque année, dans les exercices d’approfondissement qui sont proposés, comme dans l’adjonction de nouvelles thématiques.
Compétences et savoir-faire développés
La formation cherche à articuler des savoirs et des approches souvent disjoints, relevant d’un côté des sciences de la nature et de l’écologie, de l’autre des sciences humaines et sociales. Elle accorde une grande importance aux modalités pratiques de l’action, car les connaissances ne garantissent pas à elles seules une efficacité de l’agir. Les grands exercices proposés tout au long de la formation sont l’occasion de mettre en pratique les savoirs acquis et de les faire dialoguer en vue d’une gestion active des problèmes et des projets.


Identifier les conditions et les moyens d’une action en configurations complexes et multiacteurs
La préservation de la biodiversité repose classiquement sur des espaces dédiés à la "protection de la nature". Mais l’avenir du vivant se joue aussi et pour une large part, dans et au-travers des territoires où opèrent de nombreux acteurs aux logiques et aux intérêts disparates. Dans ces territoires, des approches spécifiques sont requises pour assurer une prise en charge active, motivée et coordonnée du vivant. Des approches faisant appel à des techniques de médiation, de négociation et de facilitation permettent de formuler un diagnostic stratégique et d’identifier les conditions et les modalités nécessaires à une co-action complexe et multiacteurs.
Réaliser un diagnostic de connectivité afin d’identifier les secteurs-clés pour la protection et la restauration
La perte et la fragmentation des milieux naturels constitue un facteur majeur du déclin de la biodiversité, limitant les déplacements des espèces et compromettant le fonctionnement des écosystèmes. L’analyse de la connectivité des habitats, reposant sur les concepts d’écologie du paysage, permet d’identifier les continuités écologiques à préserver ou restaurer. Pour cela, la modélisation spatiale par la théorie des graphes offre un cadre puissant pour cartographier les réseaux écologiques, évaluer leur connectivité et simuler l’impact d’aménagement. Construire ces modèles implique de choisir et d’ajuster leurs paramètres en fonction des objectifs de l’étude et des données disponibles, tout en adoptant une approche réflexive sur leur usage, afin de proposer des stratégies adaptées aux enjeux de conservation et de restauration.
Recueillir des informations sur les relations au vivant pour favoriser la compréhension et l’action
S’intéresser aux relations au vivant de tout type d’acteur est essentiel si l’on souhaite améliorer les connaissances liées à ce vivant, augmenter la sensibilisation des individus à la biodiversité et ainsi encourager des formes d’action qui lui soient favorables. Le recueil des informations sur ces relations ne peut généralement se faire qu’en échangeant avec les individus, en les questionnant sur ces rapports et sur leurs expériences. Les enquêtes de terrain qualitatives et quantitatives et les observations participantes nous apportent une compréhension des contextes sociaux, culturels et institutionnels qui influent sur la prise en charge du vivant dans les territoires. Ces approches éclairent les liens entre humains et non humains, révélant les connaissances, les savoirs, les perceptions et représentations, individuelles et collectives, qui façonnent nos relations à la biodiversité.
Élaborer un indicateur collaboratif pour sensibiliser et mobiliser autour du vivant
Un indicateur permet d’évaluer un état de biodiversité, de le faire connaître et de suivre son évolution. Il est généralement considéré comme un outil d’aide à la décision. A partir d’une mise en situation réelle sous forme de jeu de rôle d’acteurs (gestionnaire de la biodiversité, aménageur, représentant de la société civile, association, politique, etc.), nous proposons aux étudiants d’élaborer un indicateur réunissant leurs diverses connaissances et compétences. Cet exercice sera l’occasion de se questionner sur les éléments, à la fois biophysiques, sociaux et territoriaux, qu’il est nécessaire de retenir pour la mise en place d’un indicateur, ainsi que sur le poids de chacun de ces composants dans le calcul de cet outil. Pensé ici comme une mise en commun de plusieurs approches, notions et expériences, cette démarche participative invite à réfléchir aux différentes étapes à suivre pour passer de la production de données sur le vivant à la sensibilisation et à la mobilisation pour ce vivant.
Des parcours diversifiés
Deux grands parcours sont possibles en BIOTERRE.
Dans le parcours stage-recherche, le temps universitaire se limite au premier semestre (du lundi au vendredi, de septembre à fin février), le second semestre étant consacré à la réalisation d’un stage ou d’une recherche pouvant aboutir à un projet doctoral.
Dans le parcours alternance, les étudiants ont cours à l’Université les jeudis et vendredis, de septembre à juin ; trois jours par semaine, ils travaillent, en tant qu’apprenti, dans la structure (entreprise, collectivité, association) qui les a recrutés au titre de l’alternance. Ces deux parcours présentent des opportunités et des contraintes différentes. Un équilibre est recherché entre ces deux parcours dans la composition des promotions. Chaque année, le Master accueille également quelques personnes en reprise d’étude ou en conversion professionnelle.